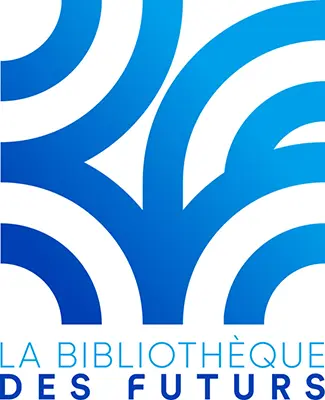Interprétations
Le grand affaissement
Les maisons qui s’affaissent, l’érosion des côtes, le mouvement de la Terre et en contrepoint, partout, l’immobilisme des Hommes. Tout bouge, sauf nous ?
Le grand affaissement, écho du stupide grand remplacement qui conviendrait aussi ici comme titre, les eaux qui remplacent les terres habitables. Et chez Claire Béchec, le « grand engloutissement » ! Nécessité frappante des auteurs de se ré-approprier le lexique, de développer une pensée où le danger n’est pas l’autre mais nous tous.
Le grand affaissement : Basile M choisit le mot affaissement et non effondrement, il nomme l’action douce et lente de l’érosion. Les habitants sont figés dans l’attente terrible, ils sont mis en pause jusqu’au dénouement final (et ultime : la mort).
Je vois son texte comme une métaphore de la lenteur des prises de décision actuelle face aux enjeux climatiques. La lenteur du processus conduit à la non action, on a « le temps de voir venir » et « aujourd’hui, ni moi ni personne ne peut plus y faire grand chose. » Un dangereux sentiment d’impuissance découle de cette lenteur, de cette attente du pire.
C’est aussi la théorie du biais du présent : les humains ont tendance à privilégier les récompenses immédiates et à sous-estimer les conséquences futures. Notre cerveau reptilien est programmé pour réagir aux menaces immédiates plutôt qu’aux dangers lointains. C’est une « myopie temporelle ». On accorde moins de poids aux événements du futur qu’à ceux du présent.
Pour les habitants d’un Saint Brieuc qui s’affaisse, il s’agit aussi de remboursements qui ne viendront pas, d’enfants qui hériteront de maisons sans valeur. Les assurances voraces, le monde de la finance : le perdant du grand affaissement ne sera pas évidemment le grand capital. Cette myopie temporelle appliquée à la finance, c’est la théorie de la tragédie des horizons. La difficulté pour les marchés à se concentrer sur des horizons à long terme, obsédés par les rapports trimestriels et, au mieux, les bilans annuels. Conduits à la sous estimation des risques, et encore une fois à l’inaction collective. Cela nous rappelle la nécessité de repenser les cadres temporels utilisés dans les décisions économiques et politiques. Cependant, il semble que la théorie de la tragédie des horizons et la myopie temporelle deviendront bientôt obsolètes : l’horizon des tragédies se rapproche, et l’inaction demeure.