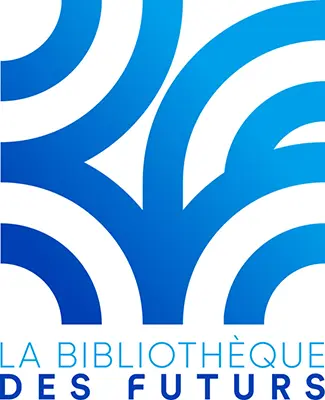L’Assemblée Interprétative du 9 mai 2022

Programme
NOS FUTURS
Lundi 9 mai à la Villa Carmélie
De 16h à 20h en deux parties: 16/18 et 18/20
Séances ouvertes à toutes et tous.
Depuis plusieurs mois, secoués par l’irruption dans nos vies de l’impossible – le virus, la guerre – et par le climat politique, nous avons voulu réagir. Nous avons construit un lieu, la Bibliothèque des futurs, et une méthode : la passage par la fiction. Nous croyons dans la puissance de l’imagination. Nous croyons dans la force de représentation de la fiction. La fiction a souvent un coup d’avance.
Vers quoi dérivons-nous?
Quels sont les visages du futur?
Des écrivaines et des écrivains ont écrit pour la B.D.F. des nouvelles, des récits, de courtes pièces de théâtre. Ils mettent en mots et en images LES TRACES DU FUTUR dans nos actes, dans nos langues, dans nos modes de vie.
Vivons-nous à notre insu des métamorphoses, de petites et grandes métamorphoses?
Le 9 mai, de 16h à 20h, à la Villa Carmélie de Saint-Brieuc, nous entendrons des morceaux choisis de 10 fictions qui mettent en scène des futurs. À partir de ces fictions nous imaginerons ensemble des devenirs. Nous co-construirons des possibles.
Les extraits seront choisis dans les œuvres suivantes : Or comme ordure de Frédéric Ciriez, Mourir bio d’Alexandre Koutchevsky, L’Andréide et Rudimenteurs d’Alexis Fichet, Infixés de Jean-Marie Piemme, F.A.M. Femme Animal Machine de Gildas Milin, Eden (Les cloches brunes) de Waddah Saab, On passe à autre chose de Roland Jean Fichet, Bunkering de Frédéric Vossier, Last level de Julien Gaillard, Rémie de Léa Schweitzer.
Roland Fichet, Annie Lucas, Anne Le Baut, Bernard Étienne, Alexandre Solacolu
Photos
Bilans
Chères et chers écrivaines et écrivains,
Lundi 9 mai s’est tenue une assemblée grand format de La bibliothèque des futurs au conservatoire de Saint-Brieuc – Villa Carmélie. De 16h à 21h quelques cent personnes ont pris place dans une vaste et agréable salle qui fut une chapelle. Six actrices et acteurs ont lu avec précision et rythme 14 passages des nouvelles et pièces envoyées par les écrivaines et écrivains. Les textes ont résonné très fort. L’articulation poétique/politique a tracé des lignes de sens et découpé des espaces de pensée qui ont nourri les interventions des participants. Des participants ont réagi par écrit suite à cette première assemblée interprétative publique.
On peut lire leurs textes dans la rubrique « INSPIRATIONS / EXPIRATIONS »
Parmi les thèmes abordés: L’art d’habiter présent sous diverses formes dans les nouvelles et pièces a jeté des passerelles entre plusieurs plans.
L’art d’habiter un territoire : les paysans et maires de communes rurales présents ont développé ce point.
L’art d’habiter son corps : poussé par un thérapeute, ce thème a suscité des points de vue sur le genre, l’infixité (Infixés de JM Piemme), la génération, l’amour, les figures du sexe, la séparation (Les dernières pages de Eden – les cloches brunes de Waddah Saab). Même le mot inconscient a réussi à s’infiltrer.
L’art d’habiter le monde: mise au point tranchante d’une femme guadeloupéenne sur la propension de l’homme blanc à parler au nom de la terre entière.
L’art d’habiter la littérature a eu du mal à tenir son rang dans le débat mais a nourri des conversations denses pendant les pauses et plus tard dans la soirée – et le lendemain- entre des autrices, des auteurs (huit étaient présents) et le directeur d’une revue littéraire. La littérature comme déchet, comme entreprise de recyclage des mots et des formes, comme trace des futurs passés et à venir, comme dragueuse de l’indicible, comme explosion, comme machine à produire du symbolique.
Autre thème : L’art d’hériter et l’art de ne pas hériter. Le chateau de Goering reconstitué ( Bunkering de Frédéric Vossier nous a mis sur le chemin de l’histoire longue et de l’héritage du XXème siècle qui ne passe pas, qui ne passe décidément pas, qui revient sans cesse. L’héritage, question politique et psychique, le poids des assurances, l’envie de jeter par- dessus bord toutes les assurances ( Chercher le charme de Léa Schweitzer) ont carrément débouché sur l’hypothèse, envisagée comme une solution, de la disparition de l’humain pour sauver le vivant, hypothèse avancée par une écrivaine directrice d’un festival du livre. L’humain et le vivant, l’humain avec tout ce qui vit, l’humain et ce qu’il détruit, les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc…Comment agir? Avec qui? Que peuvent la poésie, la littérature?
Shakespeare a été appelé à la rescousse: « La sécurité est la plus grande ennemie des mortels» (Macbeth). Et R.M. Rilke: «L’avenir doit pénétrer en vous bien avant qu’il se produise.»
Un sociologue s’est agrippé à la question qui surgit dans le dixième combat de F.A.M. Féminin Animal Machine de Gildas Milin : «Est-ce qu’on aurait pu dès ce moment-là améliorer quelque chose dans cette prise de conscience? Encore une fois est-ce qu’on aurait pu changer quelque chose dans ce changement même au moment où je le vivais? »
Piste évoquée et à creuser : deux mondes s’éloignent chaque jour davantage l’un de l’autre et se déploient séparément: un monde centré sur le territoire, le local, l’écologie et un monde obsédé par le développement d’une science de plus en plus puissante dont le symbole est, ces années-ci, Elon Musk ( Dans L’Andréïde d’Alexis Fichet Elon Musk est mis en scène sous le nom de Roman Tesla).
Autre thème: La multiplication des avatars, des fantômes, des faux profils dans la fiction ( CF L’Andréïde ) et dans la réalité: la fabrication par la propagande russe d’une foule de personnes fictives sur les réseaux sociaux pour façonner les opinions et instiller un discours pro-Poutine. Une nouvelle conception du peuple assurément.
Un garagiste ému a demandé à ré-entendre quelques lignes qui se trouvent à la toute fin de Last Level de Julien Gaillard: « L’oubli est un délice, et je m’y enfonce comme, enfants, nous jouions à disparaître dans les buissons de groseilles. Le cheval est là. Tu le vois? Arrivé au bord, je ne recule pas. Il est temps. Il est temps et je tremble. Je vais quitter la ville, passer la porte, et la boue giclera sous mes semelles. » Quelqu’un a dit, citant On passe à autre chose, que le cheval nous avait accompagné toute l’après-midi.
Nous avons ouvert les séances de 16h et de 18h par le passage de Or comme ordure, une des nouvelles de récits B de Frédéric Ciriez qui inscrit d’ores et déjà la bibliothèque des futurs dans la littérature, en effet récits B est édité par les éditions Verticales-Gallimard. Juste après Or comme ordure, le premier texte qui est sorti du chapeau est Mourir Bio de Alexandre Koutchevsky. Tout un programme.
Voici, écrivaines et écrivains, un bref aperçu des échanges de cette assemblée passionnante.
Les actrices et acteurs de cette première assemblée interprétative grand format: Nikita Faulon, Jeanne François, Alexis Fichet, Frédéric Grosche, Ghislain Lemaire, Juliette Pourquery de Boisserin.
Bon printemps! Avec mes amitiés, Roland Jean
INSPIRATIONS / EXPIRATIONS
L’entreprise de la bibliothèque des futurs est singulière, tout comme celle des audit poétiques de Roland. Tu écris Roland : « L’articulation de la langue et de la poésie avec les autres plans n’est pas une gymnastique facile».
Il y a en effet un pont à problématiser entre « bibliothèque » – et les écrits qu’elle abrite – et « futurs » qui est de l’ordre du vécu anticipé. Tout le débat de l’avant et après-guerre sur l’intellectuel engagé ou organique jetait le pont entre le travail intellectuel – qui inclut la poésie ou la fiction mais les déborde – et le vécu présent à dénoncer ou transformer. Un poète comme Armand Robin est – selon moi – au cœur de cette problématique, jusque dans son itinéraire : écriture, puis seulement traduction, puis « audit politique » à travers ses écoutes radiophoniques. Mais c’est le cas aussi de tant d’écrivains, notamment les russes ( Zamiatine aurait sa place dans la bibliothèque des futurs ), Louis Guilloux…Vous traduisiez bellement cela dans l’invitation à l’assemblée du 9 mai : « Ils mettent en mots et en images LES TRACES DU FUTUR dans nos actes, dans nos langues, dans nos modes de vie ».
Mais il y a aussi un pont – ou un saut – entre assemblées interprétatives restreintes ( et leur entre-soi, leurs codes, leur confort aussi sans doute) et assemblées grand format (au risque de la haute mer). Ce n’est pas le même type de navire. La question est de savoir s’il faut tirer le bateau d’un côté ( littérature ) ou de l’autre ( société) . Les peuls que je fréquente disent que lorsque l’on est en face de ce type de dilemme il ne faut pas entrer dedans : il faut ou bien le contourner ( c’est sans doute pour cela qu’ils ont la réputation d’être fuyants, sournois ), ou bien sauter – «s’élever» – c’est-à-dire passer dans un autre monde ( c’est là qu’ils sont fascinants) . C’est la question du rapport entre réel et imaginaire.
C’est aussi celle du pouvoir subversif des mots dans une période où nous connaissons surtout les mots anesthésiants du pouvoir, distillés dans les « éléments de langage » ou les mots-valises.
D’une certaine façon Anne Auffret transpose cette question de ce que l’on dit et de la façon de le dire dans le domaine du chant, de façon très intéressante. Je vous joins le lien pour l’entendre et la voir.
À bientôt
Chers ami.es,
Grand merci de nous avoir invités à cette « porte ouverte » qui nous permet de respirer dans ce riche espace que vous avez créé et vous (nous) permet de sortir des limites d’un entre-soi.
Le choc des textes tirés au hasard (?) était très intéressant, la prestation des comédien.nes excellente ; l’assemblée interprétative reste un défi, avec ses moments de grâce (heureuse irruption de l’intervention de François) et ses silences (« le silence est fait d’autres choses que ce que l’on ne dit pas« ), mais il mérite d’être posé.
Votre entreprise remue beaucoup de choses. « La vie, mélange de fictions et de vécu » : il faut aussi y ajouter les machines que nous inventons pour appréhender et conduire la vie – j’inclue les dispositifs, les règles, les rituels, les religions dans les machines – vous y avez explicitement intégré le numérique. Les assemblées interprétatives procèdent de cet ordre. Faut-il aussi y ajouter la pensée ? (« les Blancs pensent trop »).
Roland disait la difficulté de se projeter dans le futur. Nous en parlions au retour dans notre co-voiture : cette difficulté n’existait pas tant que l’horizon du progrès paraissait infini (revoir ou relire les projections optimistes que l’on faisait dans les années 50/60 sur le monde en 2000) et la question n’était pas à l’ordre du jour avant les temps modernes ; Foucault analyse bien cela dans Les mots et les choses : les questions existentielles se distribuaient différemment. C’est donc bien une difficulté du moment.
Je retiens (entre autres), du 12ème combat de F.A.M. : « la question aujourd’hui : est-ce qu’il aurait fallu…? » que je relie à l’interrogation de cette participante sur la façon dont s’était enclenché l’engrenage de l’agriculture productiviste. Il lui a d’ailleurs été très bien répondu, notamment par l’un des comédiens et par le frère de Roland : la question première a été, après la guerre, celle de la sécurité alimentaire. La question toujours actuelle est celle de la rémunération du travail des paysans, qui les a précipités dans les solutions proposées par les conseillers des chambres d’agriculture et le Crédit agricole à la fin des années 50, puis par les firmes liées à l’agrobusiness et la mue des coopératives : réduction de la pénibilité du travail et espoir de profit. Relire l’histoire de Gourvennec. Celle d’André Pochon aussi. Et puis on s’est pris les pieds dans la PAC. Est-ce qu’il aurait fallu faire autrement ? Sans doute, mais on ne peut pas revenir en arrière. La question utile est de se demander s’il faut faire autrement aujourd’hui. Elle se pose au présent pour l’agriculture et pour l’alimentation sur l’espace africain où je vois se reproduire le dilemme des paysans bretons à l’aube de la révolution agricole. Nos réponses vertueuses d’aujourd’hui ne sont pas celles auxquelles aspirent les femmes et les jeunes des campagnes africaines. Et là j’ai trouvé extrêmement pertinente l’interpellation que j’aurais aimé relancer de cette participante antillaise : Qui pense pour qui ? Qui est autorisé à penser pour l’humanité ? C’est une question qui me taraude. J’ai travaillé récemment avec un ami chercheur sur la mémoire dans le monde du développement et cela m’a amené à plonger dans mes archives pour en dégager une sélection de textes et d’articles que j’ai écrits depuis cinquante ans et d’en dresser une sorte de catalogue pour les mettre à disposition, sous forme de « mélanges », de celles ou ceux que cela intéresserait. Je vous joins pour les partager avec vous les dernières pages de ce catalogue qui cherchent à le projeter vers le futur. Elles se situent dans la même perspective que le propos de cette intervenante.
Dernière réflexion. Il y avait dans votre invitation une piste intéressante qui n’a pas pu être explorée hier : « Vivons-nous à notre insu des métamorphoses, de petites et grandes métamorphoses ?« . Nous avons eu chacun de notre côté, Yolande et moi, le même flash à ce sujet : quel est le sens de la métamorphose de cet espace de la villa Carmélie où nous nous sommes retrouvés ? ou de celle de la caserne Charner ? ou de la prison de Guingamp ou de celle de Clairvaux ? Voilà qui relance sur la question de l’Histoire de l’ami thérapeute (qui ne m’a cependant pas complètement convaincu), sur celle du sacré, et celle – absente de nos échanges – du profit (Novotel a un plan de réinvestissement luxueux du patrimoine, sans états d’âme).
Voilà donc, en guise de contribution marginale à la bibliothèque.
Avec encore toute notre amitié en vous redisant la richesse qu’elle nous apporte.
Loïc et Yolande
Bonsoir Roland et Annie,
Sans doute connaissez-vous, mais voici mes petites pensées rebonds, telles que sollicitées par Roland.
Lorsqu’il a été question, lors des échanges, de ce que nous pourrions faire concrètement pour préserver la baie de Saint Brieuc, et notamment pour régler le problème des algues vertes, j’ai pensé d’une part au rôle majeur joué par Inès Léraud, cette journaliste pugnace qui a révélé les dessous implacables de cette affaire à travers la bd « Algues vertes, l’histoire interdite », d’autre part au Parlement de Loire, ce formidable projet initié par l’écrivain Camille de Toledo, qui, à l’intérieur du Polau, laboratoire de recherche à la confluence entre l’aménagement du territoire et l’art, destine une identité juridique à la Loire, afin de défendre ses droits. Cette démarche initiée dans différents pays me paraît passionnante ( et elle a le mérite de déplacer nos lignes, même si ce sont toujours les êtres humains qui parlent à la place de la Nature, mais il y a là une forme de reconnaissance qui n’est plus seulement poétique, qui s’implante dans un domaine légal) et cela peut donc constituer un levier majeur pour un rapport plus juste et plus conscient avec notre environnement.
Ne pourrait-on pas alors imaginer que la baie de Saint Brieuc à son tour soit pourvue d’une personnalité juridique ( la baie comme sujet de droit pourrait ainsi porter plainte) ? Je ne saurais aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, mais il me semble qu’il y a là un angle d’approche vraiment stimulant à explorer, d’autant plus qu’il s’articule aux arts et à la littérature en particulier ( le paysage comme matrice des récits à venir ne peut se constituer que parce qu’il est dépositaire des récits qui forment son histoire).
Merci pour cette invitation à la Villa Carmélie, c’était vivant, intéressant, et riche de voix diverses, dans ce beau lieu où projeter un peu de « transcendance » sur les vitraux de couleur.
Katell
Pasteur a inventé la rage, Freud a propagé l’angoisse.
Le mal, profitant de l’estompage des frontières entre le vrai et le faux, est bien présent : la peur de devenir un hologramme.
La tentation de virer au véganisme.
L’horreur à l’idée d’une baie saturée d’éoliennes.
Le sentiment d’impuissance face à tant de déchets…et d’algues vertes.
La crispation obsessionnelle devant la perspective du grand remplacement.
La fébrilité avant de découvrir le montant de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
L’addiction pathologique aux réseaux numériques.
La perplexité et même le doute envahissant devant le concept de maisons réversibles.
L’hésitation sur le choix du genre.
Les vaccins inventés par des forces du mal.
Le sexe sans jamais le désir de descendance.
Le virus du covid dispersé par un savant fou déguisé en pangolin.
L’écriture neutre sans libre cheminement.
Et pourtant : Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu’à leur terme, elles ont été seulement vécues »*, ou bien mal rêvées.
Les déchets ?
Ce sont tous les laissés-pour compte.
Qui n’apparaissent surtout pas dans le bilan financier des banques et des places financières.
Les déchets, ce sont les marginaux du monde globalisé.
Aux périphéries du village-monde errent les relégués. Maintenus à distance par des murs de barbelés réels ou fictifs.
Sous nos yeux. Mais sans égards, loin de nos regards. Loin de nous. Et pourtant si près. Invisibilisés.
Broyables sont les auteurs, imbroyables sont leurs œuvres. Et d’autres émergent qui les prolongent et les renouvellent.
Face à de telles dérives des continents obscurs de nos consciences, élever des digues ? Eriger un grand barrage ?
May be, or not ?
But don’t forget : small is beautiful !
Il s’agit de combattre, et ce n’est qu’un début !
« Donnez-moi un levier et un point d’appui, et je soulève la monde »**
Nous étions des enragés.
Ils sont des angoissés.
Nous tous, sommes censés savoir d’où nous venons. Mais où donc allons-nous ?
Et pourtant, nous sommes. Résilience, vous avez dit résilience.
*Annie Ernaux , Le jeune homme
**Albert Einstein