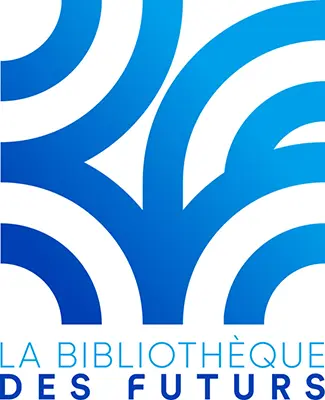Le grand affaissement – Basile MULCIBA
Ouverture
Le grand affaissement
La porte de la salle de bain ne ferme plus. Héloïse est venue me trouver ce matin pendant que je nettoyais la vaisselle du petit déjeuner : « Papa, la porte de la salle de bain ne ferme plus ». « Comment ça elle ne ferme plus ? ». Elle m’a pris par la manche et m’a emmené pour que je le constate de mes propres yeux. « Regarde » elle m’a dit debout à l’intérieur et en tirant sur la poignée, « tu vois, elle ne ferme plus ». Et en effet, cette porte en bois, vitrée sur la partie supérieure d’un verre poli pour laisser passer un second jour, ne rentrait plus dans son encadrement. J’ai forcé comme une mule pendant quelques minutes puis j’ai déclaré forfait. Héloïse ne voulait surtout pas se doucher la porte ouverte alors je l’ai bloquée avec une chaise.
Maloé, sa petite sœur, a accouru en pyjama, attirée par cette étrange agitation pour un dimanche matin. Elle m’a regardé installer la chaise avec un grand sourire où plusieurs de ses dents manquaient.
Sur le coup, je ne me suis pas inquiété. J’avais décidé d’emménager dans une région autrefois connue pour son humidité, ses semaines pluvieuses, ses maisons de granit difficiles à chauffer en hiver et ses caves rongées par la mérule. Mon appartement, à l’étage d’un petit immeuble vieux de plus de 100 ans ne fait pas exception : tout le monde sait que les vieilles bâtisses bretonnes sont vivantes, elles bougent, gémissent et leurs portes réagissent au temps.
Maloé a voulu que j’installe la chaise exactement comme je l’avais fait pour sa sœur qui évidement s’en est agacée. Cela nous a valu des cris toute la matinée sans que je comprenne tout à fait de quoi il était question.
Points de vue
« Le grand affaissement » programmé par le titre fait écho au « grand engloutissement » annoncé dans le récit de Claire Béchec, accueilli au même moment sur le site de la Bibliothèque des futurs et enrobé d’une douceur similaire. Perception aigüe du quotidien, regard sur la baie dans l’attente de l’inéluctable, acceptation quasi stoïcienne de l’irréversible, ces deux récits au bord de l’eau se font écho jusque dans le mouvement inversé des choses – montée des eaux sur les îlots, descente de la ville qui s’affaisse – et tous deux commencent par le petit bout de la lorgnette.
Plus précisément, dans le texte de Basile Mulciba, « La porte de la salle de bain ne ferme plus […] De toute façon, aujourd’hui, ni moi ni personne ne peut plus y faire grand-chose… ». Voici en peu de mots – après une compression un peu forcée je l’avoue – la nouvelle résumée. Raccourci trompeur certes, car dans son déploiement, le texte, tel un rideau lentement levé sur une scène de crime, dévoile par petites touches l’ampleur d’une catastrophe jusque là invisible.
Donc, au commencement de l’histoire, le futur ouvre une brèche discrète dans l’ordinaire d’un jeune père de famille tranquille. Quoi de plus simple et de plus anodin qu’un petit tracas domestique ? Et pourquoi s’en faire ? Insidieusement, le petit dysfonctionnement provoque des micro-décalages – comme dans les pièces de Michel Vinaver (1) – et produits de légers glissements dans cette ambiance dominicale censée être cool : « étrange agitation pour un dimanche matin ». Cette remarque anodine – ce n’est pas comme d’habitude – renvoie à « l’inquiétante étrangeté » freudienne, à savoir l’irruption d’un inconnu dans le connu, une sorte de déformation assez angoissante de l’intime. Avant d’être effrayante, la situation échappe à l’entendement : « des cris toute la matinée sans que je comprenne tout à fait de quoi il était question ». Le décalage est aussi entre le fait et sa perception par le narrateur : plutôt dans l’incompréhension au début, vaguement puis franchement inquiète ensuite, et pour finir claire mais apaisée.
La situation n’est pas sans rappeler le scénario de Dans la cour, un film de Pierre Salvadori sorti en 2014 où Mathilde, nouvellement retraitée, s’inquiète d’une fissure dans le mur de son appartement menaçant d’après elle la sécurité de l’immeuble. « Dans la cour : autour d’une fissure intime, un ballet de grands dépressifs », titrait le journal Le Monde (2). Dans le film comme dans la nouvelle, les protagonistes se mobilisent et s’agitent – un peu vainement -, sauf que si l’une est un peu fêlée, l’autre est plutôt raisonnable et pragmatique. Au début de notre récit la fissure dans l’appartement provoque dans la petite cellule familiale situation cocasse et fou rire, une réponse collective et joyeuse à un problème assez inquiétant.
« Étrange agitation pour un dimanche matin », ce pourrait être le titre de la nouvelle, tant la phrase fait signe : le quotidien et une situation paradoxale ne sont-ils pas les ingrédients d’une comédie ? À moins que… il y a tout de même une ombre. Michel Vinaver disait écrire des comédies parce qu’il était pessimiste, et l’ombre se glissait dans les interstices et les silences de ses dialogues. De même, notre texte se colore d’une intranquillité mi comique-mi tragique, préambule d’une crise à venir.
Propice à la comédie (au sens large), ce frottement dans le récit entre deux temporalités. D’une part il se situe dans l’ici et maintenant de Saint-Brieuc et les personnages y font « une balade au vent de novembre dans le Parc de la vallée du Goüedic ». D’autre part cette vallée, que Trésors de Lucie Taïeb révèle peuplée d’ombres, ainsi que « les vieilles bâtisses bretonnes » offrent un autre ancrage dans un passé plus ou moins mythique, mystérieux certes mais connu, et donc rassurant, car « tout le monde sait qu’[elles] sont vivantes, elles bougent, gémissent et leurs portes réagissent au temps ».
Vecteur de tragédie, venue du futur percuter le bel agencement du temps : la fissure.
La fissure, c’est le noeud dramatique où tout s’imbrique, l’élément déclencheur dont le motif surgit pour déchirer toute certitude, un thème cher à l’auteur et déployé dans son roman Hors saison (3). Ce sont « les carreaux dont les joints se détachent, les fissures fines qui serpentent sur les murs, au plafond, une fissure plus importante en train de naître au coin de la pièce ». On comprend que la fissure est aussi un élément déclenché par un certain état du monde, voire une métaphore de la façon dont nous l’habitons.
Motif tant pictural que littéraire, et déjà très présent dans l’œuvre de Roland Jean Fichet, je pense à Fissures (4), mais aussi au chêne creux de Suzanne (5) et au masque fêlé de Comment toucher (6), où il appert qu’il donne à voir cette part du réel que la conscience aveugle ignorait jusque là. « Tous les auteurs de la BDF, écrit Roland Jean Fichet (7), partagent une intuition : les puissances de la langue, de la fiction et du mythe sont grandes. Elles peuvent rendre visible un réel invisible. Elles peuvent libérer des possibles. Elles peuvent donner forme à des mondes. » Les fissures font voir ce qui se produit « dans un mouvement invisible et imperceptible » à l’échelle du narrateur ; quant à la fiction, elle nous donne à voir concrètement cet état du monde où nous avons déjà basculé.
Nous y voilà. Le Grand affaissement extrapole avec lucidité à partir d’une situation déjà relayée par la presse régionale (8) : le retrait-gonflement des sols argileux, provoqué par des conditions climatiques extrêmes. Soit, en imaginant l’enfoncement de toute une ville, il donne une forme concrète à nos appréhensions, mais il ne nous apprend rien.
Ce qui retient l’attention, c’est l’irruption dans le quotidien et sa banalité de quelque chose qui était déjà-là mais qu’on ne voyait ou ne voulait pas voir. Il y a eu l’arsenic, le plomb, l’amiante, révélés dans toute leur nocivité après des siècles d’invisibilité. À présent nous sommes tous infestés de Pfas, ces polluants éternels que nos corps ne peuvent ni détruire ni métaboliser. Ils sont rendus visibles par le discours scientifique et militant d’une part et nos cancers d’autre part. Aussi, qu’on s’indigne, qu’on cherche, qu’on lutte, ou qu’on ne fasse rien, de toute façon nos corps sont irrémédiablement endommagés – tel l’immeuble fissuré du Grand affaissement. Le personnage au début aveuglé commence par s’étonner, puis essaie de savoir, agit, finit par alerter, s’indigne mollement, dans un entre-deux kafkaïen : « nous avons tous basculé dans cette zone grise, dans ce territoire nouveau, nous les apatrides de la couverture assurantielle, les pas encore sinistrés mais déjà inassurables. » Néologismes et ironie latente viennent ici désamorcer la perception du pire.
Le passage sur le théâtre « ou ce qu’il en reste puisqu’il accueille davantage de hackathons que de représentations », fait un clin d’œil au texte de Roland Jean Fichet, On passe à autre chose, et renforce l’idée de confusion et d’impuissance face au désastre.
Mais au-delà du fait et de sa perception, il y a une piste que l’auteur nous propose sur un canapé, sous la forme d’un retour sur soi pour retrouver la sensation d’une liberté intérieure – souvenirs d’enfance et rêve d’envol. Et du temps pour penser et pour imaginer. Devant l’inéluctable, le non-su, l’inconnu (dont Claire Béchec fait aussi le sujet de sa nouvelle), le plus sage est peut-être de s’incliner : « De mes yeux inhabités je contemple la baie qui se rapproche et suis chaque jour un peu plus convaincu que je ne bougerai pas. » Non pas de ne rien faire comme un bon stoïcien, mais de choisir d’habiter le monde en locataire. Une sortie salutaire du capitalisme pour dégriser la zone.
1- La Demande d’emploi (1972) et Dissident il va sans dire (1978) de Michel Vinaver (L’ARCHE éditeur) en sont des illustrations.
2- Article de Jacques Mandelbaum, 21 avril 2014.
3 – Hors saison, Basile Mulciba, Éditions Gallimard, collection Blanche, 2023
4 – Fissures in Petites comédies rurales , Roland Jean Fichet, Editions théâtrales, 1998 : « Des fissures dans les arbres / j’y mets l’œil / je vois des choses graves. »
5 – Suzanne, Roland Jean Fichet, Editions théâtrales, 1993 : « La pièce se passe en Bretagne. Suzanne, le personnage éponyme, décide d’écrire un livre sur son père qui s’est pendu en 1957 à l’intérieur d’un chêne creux » (préface de Paol Keineig, p.1) ; dans Comment toucher (cf note 5), on retrouve le chêne creux, porteur de « poudre de mort, substance d’ancêtre »
6 – Comment toucher, Roland Jean Fichet, Editions théâtrales, 2010 `: « Un beau jour, à midi, le masque fêlé s’est dressé devant moi […] Je ne pouvais détacher mon regard de la crevasse grouillante qui déchirait cette figure géante. Suffisamment grande cette crevasse pour que je m’y… glisse »
7 – Comment ça a commencé – https://www.bibliothequedesfuturs.com/c-est-quoi-l-idee/
8 – https://www.ouest-france.fr/economie/immobilier/votre-maison-est-elle-exposee-a-un-risque-de-fissures-une-nouvelle-application-vous-repond-072b5b5a-19db-11ef-b342-8a0320f60fa8
Comment ça commence ?
« La porte de la salle de bain ne ferme plus.»
La première phrase du récit de Mucilba est à la fois banale et catégorique, et crée une première alerte, légère : « Sur le coup je ne me suis pas inquiété.» À contrario du narrateur, pour la lectrice l’alerte s’amplifie : « Un matin, j’en ai trouvé une qui se balançait mollement au-dessus le vide. Cela m’a interrogé mais là-aussi, je n’ai pas cherché plus loin. Je n’ai plus la force d’analyser les choses (…) Je me suis levé, lentement, j’ai observé autour de moi et j’ai commencé à voir : les carreaux dont les joints se détachent, les fissures fines qui serpentent sur les murs et au plafond, une fissure plus importante en train de naître au coin de la pièce ».
Mulciba écrit : « J’ai commencé à voir». Ça se dérègle. L’appartement n’est plus d’aplomb et d’équerre. La prise de conscience de ce dérèglement se fait petit à petit, parce que les faits insistent, parce qu’une amie l’invite à les prendre au sérieux. Les mots dérèglement, dérégulation ont envahi le vocabulaire médiatique et politique et ont – peut-être ? – créé une forme d’anesthésie, voire de résignation chez une partie d’entre nous.
« Je n’ai pas cherché plus loin. Je n’ai plus la force d’analyser les choses ». On ne peut que deviner pourquoi le narrateur n’a plus la force de…Un peu plus haut, il dit : « Ce que mes précédents postes m’ont apporté à moi, ce sont des semaines de 80 heures, des insomnies sévères, un vide émotionnel, des colères monstrueuses et cette impression de ne plus savoir réfléchir.» En quelques mots, Mulciba décrit l’immense fatigue des cadres de haut vol, rincés, exténués par les contraintes d’un poste et de responsabilités dévoreurs d’énergie.
Une hypothèse : notre société capitaliste libérale avancée fabrique les conditions de l’aveuglement et de la surdité de ses élites. Le narrateur met beaucoup de temps à voir, puis à comprendre ce qui se passe dans sa maison.
Le tempo du récit
Le titre «Le grand affaissement» donne en quelque sorte le tempo du récit. Pas de catastrophe ici, de rupture brutale comme dans plusieurs oeuvres de la BDF :
- Explosion nucléaire en France dans la fiction Abandonner qu’est-ce que tu t’imagines ? de Fanny Mentré
- Pandémie mondiale dans Le repos du tigre de Stéphane Nappez
- Apocalypse climatique dans Les jardins d’Electroplolis de Lancelot Hamelin
- Invasion des déchets dans Rudimenteurs de Alexis Fichet
L’écriture est factuelle, l’auteur rend compte des faits chronologiquement, comme si tout était inéluctable dans la maison, dans la ville et dans la famille elle-même. Après la séparation d’avec l’épouse, viendra la séparation d’avec les enfants :
« Isabelle ne veut plus que les filles viennent chez moi. « Trop dangereux » m’a-t-elle dit au téléphone, alors que nous savons bien que, s’il se passe tous les jours quelque chose, le changement est si infime que je suis tranquille pour des années.»
Saint-Brieuc, ville et personnage
Comme Frédéric Ciriez dans Or comme ordure, Basile Mulciba fait de la ville de Saint-Brieuc à la fois le paysage et un personnage de sa fiction :
« Étrangement, mon regard se pose aussi sur le viaduc qui enjambe le port du Légué, que je vois depuis cette même position. Ils ne vont pas tarder à le condamner. Il me captive, comme s’il recelait une réponse sur mon envie de revenir ici et d’y rester. Je ne suis plus si sûr que ce soit la mer mais plutôt ce bout de route qui me rattache le plus à ce paysage.»
Dans Or comme ordure, le narrateur voit en rêve ce viaduc précisément « s’affaisser » : « …et tout à coup les piles de béton de l’édifice s’affaissent sur elles-mêmes en un fracas sourd et lent, et je vois la masse de béton s’effondrer, s’ouvrir, aspirer les véhicules comme une corne d’abondance négative, …»
D’autres auteurs et autrices ont ainsi mis la ville de Saint-Brieuc au centre de leurs fictions. On pense à Louis Guilloux bien-sûr ( cf Le Sang noir, Le Jeu de patience, Le Pain des rêves… ), à Christian Prigent ( Grand-mère Quéquette, Demain je meurs, Les enfances Chino…) à Mérédith Le Dez (Baltique)
Contempler
« Revenu à mon immeuble je m’installe dans le canapé, ma position favorite, celle pour laquelle j’ai acheté cet appartement, face à la grande fenêtre qui donne sur la baie illuminée et scintillante. Ici je perds toute notion du temps…»
À plusieurs reprises, le narrateur cite cette baie de Saint-Brieuc présente dans d’autres textes de la BDF (Trésors de Lucie Taïeb et Or comme ordure de Frédéric Ciriez). À la fin du récit, il écrit :
« De mes yeux inhabités je contemple la baie qui se rapproche et suis chaque jour un peu plus convaincu que je ne bougerai pas. »
L’apaisement chez le narrateur survient chaque fois qu’il s’assoit sur son canapé et contemple le paysage maritime. L’immobilité dans la contemplation reste la seule réponse apaisante après des mois de luttes administratives.
Dans la fiction de Claire Bechec, Eaux-fortes, le narrateur révèle combien la contemplation du paysage l’apaise alors que la catastrophe de la montée des eaux est en marche depuis cent ans :
« Plusieurs fois par semaine, je sors mon violoncelle et je joue face à la mer. J’aime ces eaux voraces qui nous ont presque tout pris, j’aime m’y baigner quand il fait beau, je joue de la musique pour elles. Je ne leur en veux pas de leur intrusion. Elles nous enveloppent comme une chaleur primordiale dans laquelle nous pourrions finir par nous immerger de nouveau.»
Dans ces deux récits, écrits quasiment en même temps, on assiste à deux réactions identiques chez les protagonistes : la conscience des périls à venir n’entraine pas de révolte, la lucidité s’accompagne d’une forme de résignation, peut-on dire heureuse ? Sans doute pas, mais apaisée oui.
« La musique grave des cordes tient à distance les mots que j’ai entendus, la disparition de mon monde, la vision des oliviers noyés, de la maison engloutie. Je ferme les yeux et j’oublie que je me tiens sur le bord de l’abîme. »
Le personnage – narrateur du Grand Affaissement est le frère d’âme de Yann, le personnage principal du premier roman de Basile Mulciba, Hors saison (1). Futur médecin en rupture d’études, Yann quitte tout pour devenir saisonnier dans une station de ski au bord de l’abandon – la neige n’arrive pas. Le narrateur du Grand affaissement, un ancien de l’ENA, a renoncé aux responsabilités de premier ordre et au prestige qui en découle pour occuper un poste à mi-temps au Conseil Départemental des Côtes d’Armor. Un détachement tout gracquien – on pense à Aldo dans Le Rivage des Syrtes (2) – le mène, sans qu’il en ait encore conscience, aux avant-postes d’une catastrophe climatique : « le sol se dérobe » sous les immeubles de la côte .
Le propre de l’impensable est d’émettre des signaux faibles (3) : « la porte de la salle de bain ne ferme plus ». En finesse, la composition du texte traduit quasi physiquement ce moment où, dans une vie, une famille, un territoire, « le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger. » (2) : de portes ouvertes en « fissures » dans le bâti, de fissures en « trou » sous le perron d’une maison voisine, l’enquête descend toujours plus profondément vers « le substrat géologique de l’agglomération » dont on apprend finalement « la susceptibilité aux variations climatiques » .
Quant à la ville de Saint-Brieuc, elle est à peine plus dystopique que les villes actuelles : un peu plus laide, plus impersonnelle, plus décérébrée : une salle de sport virtuel à la place d’un cinéma d’art et essai, des commerces automatisés, des salles de théâtre dédiées aux hackathons, mais aussi des relations humaines plus hésitantes, des démarches administratives plus opaques…. À peine plus qu’aujourd’hui et rien n’empêche « les pas encore sinistrés mais déjà inassurables » de rencontrer le maire et de se constituer en associations .
Dans Eaux fortes de Claire Béchec où le narrateur est confronté à la montée irrémédiable de la mer autour de son île, l’alerte prend plutôt la forme d’un ostinato progressant à bas bruit, le souvenir d’un message entendu mais refoulé jusqu’au soir : « Qu’a dit la radio ce matin déjà ? Je suis distrait aujourd’hui. »
« Cet appartement, je ne pourrai jamais le vendre. Cet immeuble, il ne s’écroulera pas avant 20 voire 25 ans. Pas besoin de me presser, j’ai le temps de voir venir comme on dit. De toute façon, aujourd’hui, ni moi ni personne ne peut plus y faire grand-chose. »
Que reste-t-il à vivre et à désirer quand plus rien ne peut être ni réparé ni anticipé ? Est-ce que la suspension du temps dans un monde abîmé fait vibrer différemment notre rapport à l’espace, aux autres, à soi-même ? « Non, la terre ne sera pas retrouvée, il y a eu blessure » dit Camille de Toledo dans Une histoire du vertige (4). Entre chronique et parabole, les récits de Basile Mulciba et de Claire Béchec mais aussi celui de Fanny Mentré, ABANDONNER – Qu’est ce que tu t’imagines ? se construisent dans la blessure, révélant «les fines attaches qui permettent que la vie tienne au monde », « l’infini détail des relations qui rendent la vie possible »(4).
Le possible ne se traduit pas par le seul ajustement à ce qui arrive. Ce qui me touche le plus chez ces trois personnages, c’est l’intensité de leur désir propre au moment même où ils ne peuvent qu’accepter leur fragilité :
– Tenir la position du guetteur pour qui le futur n’est jamais une histoire racontée d’avance : « Réfugié le plus haut possible au-dessus du destin, sur un toit que je n’aurai peut-être pas la force de quitter, sauf pour me laisser flotter vers le monde qui suivra. » Eaux fortes.
– Faire du paysage un espace du dedans indéfiniment vivifié par la mémoire : « Je suis chaque jour un peu plus convaincu que je ne bougerai pas. »
« La rocade se resserre, elle serpente puis débouche sur ces enjambements majestueux, cernés par les mille teintes de vert, de bleu et de gris, entre la baie et les vallées, les immeubles de granit et les maisons de lotissement. Tapi sur le siège arrière, j’avais l’impression de voler. Ce qui ne bouge pas, ce sont les souvenirs. » Le grand affaissement.
– S’épuiser encore à maintenir le sens de sa présence au monde : « Je ne suis pas certaine d’avoir encore la force de m’intéresser à ce qu’est la vérité. J’ai 54 ans, je suis vieille, je suis fatiguée. » ABANDONNER – Qu’est-ce que tu t’imagines ?
« J’ai le temps de voir venir comme on dit » . Je suis tentée de prendre à la lettre l’expression « voir venir » qui me renvoie au roman Hors saison : « Yann voulait voir. Il voulait assister, être témoin de ce qui allait advenir, continuer à vivre, à s’imprégner, à arpenter cette station et ce recoin isolé de montagne qui, chaque jour, se vidaient, se retiraient et s’effaçaient un peu plus du monde. »
(1) Basile Mulciba, Hors saison, éditions Gallimard, 2023
(2) Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, éditions Corti, 1951
(3) En avril 2025, le journal Le Monde titrait un article par une phrase de l’écologue Philippe Grandcolas : « On assiste à un effondrement silencieux des populations d’insectes, il est complètement fou que l’on n’en parle plus »
(4) Camille de Toledo, Une histoire du vertige, éditions Verdier, 2023
La ville de Saint-Brieuc repose sur un réseau neuronal de failles géologiques.
Cette histoire commence par un mouvement contraint, une rencontre fortuite entre deux forces opposées, une porte et son encadrement.
Dès les premiers paragraphes, on comprend qu’il se trame quelque chose en dessous de cet appartement, que l’origine de l’action « dans le fond » serait la rencontre souterraine de roches qui, dans leur dialogue, seraient en conflit, front contre front. On en viendrait presque à questionner le professeur Liedenbrock*
il serait aussi question de retrait et de gonflement, du retrait des habitants face au problème qu’ils découvrent petit à petit puis du gonflement de leur colère, à moins que cela ne soit tout simplement d’argile dont il est question, somme toute l’Adam est absent du récit.
Le quartier de Saint-Brieuc où habite le personnage principal, un homme dont le prénom a disparu entre les mots, n’est pas précisément situé ; mais en regardant les cartes géologiques de la ville de Saint-Brieuc, tout devient plus clair. Que se passe-t-il là-dessous ?
La vallée de Gouédic est, d’un point de vue géobiologique, ce que l’on appelle « une zone de faille », la roche plus tendre s’est érodée et a donné naissance à une vallée. Ces zones de failles peuvent être soumises à de nombreuse nuisances et les faire remonter à la surface, et des failles à Saint-Brieuc ce n’est pas ce qui manque. Elles sont aussi le visage de la ville, en « bonne mère » de famille elles sustentent de leur érosion la grande baie.
Sur le lieu même de ce récit l’exposition au retrait et gonflements des argiles est classé en exposition faible pourtant sournoisement ils se trame quelque chose.
Cette configuration géologique vient ajouter sa signature, une signature en deux dimensions, celle du temps et celle du mouvement.
La ville de Saint-Brieuc repose sur un réseau neuronal de failles géologiques, de 650 millions d’années, elle est assise sur le socle Pentévrien, tout les quartiers communiquent entre eux, dans leur inconscient, une information sans contrainte irrigue ses vallées.
Il n’en fallait pas moins pour que les réactions piézoélectriques dans les profondeurs de la ville se manifestent et se fassent entendre, tout comme les habitants prenant conscience de leur malheur.
Toute la ville est sous tension. Les cours d’eau ont emporté avec eux les films du Club6, les magasins des Champs et les commerces de la rue Saint-Guillaume.
Tout laisse donc à penser qu’une raideur pourrait gagner le personnage, il n’en n’est rien. Il se laisse porter par les mouvements de terrain après une période d’incompréhension et d’anxiété.
Ensuite il observe.
A la surface, « La Vi » (l’Assistante Virtuelle Intelligente) suit son court comme superficiellement immobile, mais en dessous, des bruits sourd de luttes, d’anciennes coulées, des fractures, des désagrégations surgissent encore mais à une vitesse et un temps géologique imperceptibles à l’échelle humaine.
Les communes du littoral sont mise à la même enseigne, la résistance se met en place, une résistance bétonnée contre l’érosion.
« Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut ; et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas »
Le personnage s’affaisse dans son canapé, le voilà dans ses «sous-venirs», le terrain s’affaisse sur sa chaine cadomienne, la tension dans la population est palpable, le manque de considération des services de l’état, des assurances, et les roches qui continuent d’être sous pression, en tension elles aussi.
Paradoxalement dans ce récit on finit par ressentir le bien-être de la contemplation et d’une sérénité bien étrange, surement dûe à la beauté de la nature, à sa force et à son message.
* Voyage au centre de la Terre , Jules Verne
Les maisons qui s’affaissent, l’érosion des côtes, le mouvement de la Terre et en contrepoint, partout, l’immobilisme des Hommes. Tout bouge, sauf nous ?
Le grand affaissement, écho du stupide grand remplacement qui conviendrait aussi ici comme titre, les eaux qui remplacent les terres habitables. Et chez Claire Béchec, le « grand engloutissement » ! Nécessité frappante des auteurs de se ré-approprier le lexique, de développer une pensée où le danger n’est pas l’autre mais nous tous.
Le grand affaissement : Basile M choisit le mot affaissement et non effondrement, il nomme l’action douce et lente de l’érosion. Les habitants sont figés dans l’attente terrible, ils sont mis en pause jusqu’au dénouement final (et ultime : la mort).
Je vois son texte comme une métaphore de la lenteur des prises de décision actuelle face aux enjeux climatiques. La lenteur du processus conduit à la non action, on a « le temps de voir venir » et « aujourd’hui, ni moi ni personne ne peut plus y faire grand chose. » Un dangereux sentiment d’impuissance découle de cette lenteur, de cette attente du pire.
C’est aussi la théorie du biais du présent : les humains ont tendance à privilégier les récompenses immédiates et à sous-estimer les conséquences futures. Notre cerveau reptilien est programmé pour réagir aux menaces immédiates plutôt qu’aux dangers lointains. C’est une « myopie temporelle ». On accorde moins de poids aux événements du futur qu’à ceux du présent.
Pour les habitants d’un Saint Brieuc qui s’affaisse, il s’agit aussi de remboursements qui ne viendront pas, d’enfants qui hériteront de maisons sans valeur. Les assurances voraces, le monde de la finance : le perdant du grand affaissement ne sera pas évidemment le grand capital. Cette myopie temporelle appliquée à la finance, c’est la théorie de la tragédie des horizons. La difficulté pour les marchés à se concentrer sur des horizons à long terme, obsédés par les rapports trimestriels et, au mieux, les bilans annuels. Conduits à la sous estimation des risques, et encore une fois à l’inaction collective. Cela nous rappelle la nécessité de repenser les cadres temporels utilisés dans les décisions économiques et politiques. Cependant, il semble que la théorie de la tragédie des horizons et la myopie temporelle deviendront bientôt obsolètes : l’horizon des tragédies se rapproche, et l’inaction demeure.
Micro-variations
« Celui qui veut continuellement ‘s’élever’ doit s’attendre à avoir un jour le vertige. Qu’est-ce que le vertige ? La peur de tomber ? Mais pourquoi avons-nous le vertige sur un belvédère muni d’un garde-fou ? Le vertige, c’est autre chose que la peur de tomber. C’est la voix du vide au-dessous de nous qui nous attire et nous envoûte, le désir de chute dont nous nous défendons ensuite avec effroi. »
Milan Kundera, L’Insoutenable Légèreté de l’être (1984).
Les automobilistes ont pris
La quatre voie
ces cons
Ce viaduc du Gouet est pratique certes
qu’il est laid néanmoins
il me fait peur
le vertige
le bruit cette architecture
discutable
cette place envahissante
et ce bruit
ce bruit
ce bruit
je le prends quelque fois
je ne te le cache pas
même la nuit
même la nuit
je le prends même la nuit
quelques fois
les miquettes n’aidant pas
je ne te le cache pas
je le prends ce viaduc
même si les motos
même si les piétons
qui n’ont pas le droit
et je ne te le cache pas
les motos les piétons
Raccourcis raccourcis
Mais la vue du haut du viaduc
la vue du haut du viaduc
quelque hauteur
quelque
hauteur
quelque
« Le vertige c’est le désir de tomber »
écrivait à peu près
Milan K
Pour ça que les voitures
viaduc ou pas
synecdoque ou pas
c’est des cons
de ne pas attendre
ou regarder le vide
la mer
éternellement recommencée
qui part de ce viaduc
j’en suis certain
j’en suis certain
c’est comme ça
sentir le vent
qui le rappelle Valéry
se lève
Basile Mulciba

Basile Mulciba est né en Bretagne et a grandi en Guadeloupe. Sa famille vivant près de la baie de Saint-Brieuc, il a passé de nombreux étés dans les Côtes d’Armor. Passionné de géographie, il aime comprendre ce qui constitue l’identité d’un territoire, son histoire, ses habitants et sa vie quotidienne.
Son premier roman, Hors saison, paru aux éditions Gallimard en 2023, raconte le parcours d’un jeune saisonnier dans une station de ski, un hiver où la neige tarde à tomber. Comment continuer à vivre dans un monde qui change et se transforme de manière peut être irréversible ?
Comme son roman, la nouvelle écrite pour la Bibliothèque des Futurs creuse ce sillon et, sans apporter de réponses, elle dessine les contours d’un autre rapport au monde, intime et perméable.