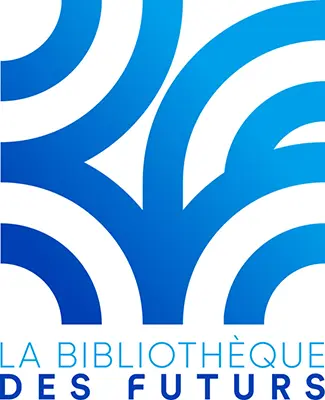Eaux fortes – Claire BÉCHEC
Ouverture
Eaux fortes
« Comment vivre sans inconnu devant soi ? »
René Char, Fureur et Mystère
C’est marée haute quand je descends sur le ponton ce matin. La distance est courte entre la maison et les quelques planches sur pilotis qui permettent d’amarrer ma barque, le café n’a pas le temps de refroidir. Je m’assois là quand il ne pleut pas, et je bois à petites gorgées tout en observant la mer, comme presque chaque jour. Les pilotis sont rongés par le sel, enveloppés d’algues qui paraissent se nourrir de leur bois, il faudra songer à les remplacer.
Je ne vois pas de bateaux aujourd’hui, c’est assez rare, d’ordinaire quelques petites embarcations passent au large dans un ballet régulier qui rappelle que presque toutes les îles sont habitées. Le calme blanc de la matinée m’invite à l’inaction.
Points de vue
Comme dans La réserve des choses, le texte de Claire Béchec est nimbé de douceur. Une douceur alourdie par la perspective du grand engloutissement à venir, assez proche de celle qui clôt Le grand affaissement de Basile Mulciba. Présence obsédante des eaux mortifères, perception aigüe du quotidien, homme face à la mer dans l’attente de l’inéluctable, acceptation quasi stoïcienne de l’irréversible, les deux récits se font écho jusque dans le mouvement inversé des choses – descente de la ville qui s’affaisse, montée des eaux sur les îlots.
Une douceur renforcée par le présent d’habitude : « C’est marée haute quand je descends sur le ponton ce matin. La distance est courte entre la maison et les quelques planches sur pilotis qui permettent d’amarrer ma barque, le café n’a pas le temps de refroidir. Je m’assois là quand il ne pleut pas, et je bois à petites gorgées tout en observant la mer, comme presque chaque jour. »
Un espace, un temps, un personnage. J’ai tout de suite pensé à L’enfant de la haute mer de Jules Supervielle (1), cette petite fille morte et seule habitante d’une ville flottante, où « le temps ne passait pas » ; comme cette petite fille, le narrateur d’Eaux fortes est prisonnier d’un îlot menacé d’engloutissement, et malgré tout le récit donne l’impression d’un temps arrêté car « la grande menace plane sur tout, sans jamais avoir été véritablement délimitée dans le temps ». Structuré, littéralement ondoyé par le champ lexical de la mer, le texte est cette « rue flottante » au milieu de l’Océan, qui ne débouche apparemment sur aucun baptême. Un texte liquide habité par un buveur de café.
Intrusive, vorace et maternelle – ses eaux «nous enveloppent comme une chaleur primordiale dans laquelle nous pourrions finir par nous immerger de nouveau » -, la mer est sœur du Léthé, le fleuve de l’oubli aux Enfers. Les âmes des hommes justes ou ayant expié leurs fautes pouvaient, après un long séjour aux Enfers, revenir dans le monde des vivants, non sans avoir auparavant bu l’eau du Léthé qui provoque l’oubli de sa vie antérieure. Ainsi Baudelaire dans Spleen et Idéal (2) auprès de la femme aimée. Ainsi les habitants des îles, dont la principale s’appelle précisément Léthé : « Je ne connais pas le monde d’avant, personne ne le connaît vraiment. L’aurais-je aimé ? L’aurais-je aimé autant que ce monde-ci ? » Et quelles fautes avons-nous donc à expier ? Nous ne le savons que trop…
La nouvelle en effet pourrait s’appeler « Le grand effacement », effacement de la mémoire certes, mais aussi du paysage, thème développé par Alice Zéniter dans DÉCHETS-(une élégie) où l’eau recouvre et détruit tout, mais ici nul déchet ni plainte, seulement un espace vide où tout pourrait … se (re)jouer ? Un espace morcelé en zones, îles, îlots, où les hommes se sont adaptés et dotés d’une nouvelle organisation et de nouvelles lois et où « il semble qu’on puisse trouver des solutions à tout ». L’anthropologue Philippe Descola nous explique que la nature en soi n’existe pas (3), mais qu’il existe des relations entre humains et non humains, entre les hommes et les animaux, les arbres, les esprits, sans que les uns ne dominent les autres – n’est-ce pas ce qui se joue dans le don du violoncelle à la mer ? – ; il nous dit aussi qu’il est urgent de changer notre vision du monde face aux crises écologiques et d’apprendre de nouvelles façons d’habiter la Terre. Je pense aux naufragés de Vendredi soir d’Alexis Fichet qui « sont 29, 13 hommes et 16 femmes, et n’épuiseront jamais les ressources qui s’offrent à eux. Ni eux, ni les centaines de générations qui suivront n’auront plus le moindre signe du reste de la planète. Ils oublieront leur origine de naufragés, ils se reproduiront, il y aura des naissances heureuses et des morts prématurées, des vies longues et des destins écourtés par les blessures, les maladies, les infections. »
Or l’eau qui envahit les rêves du narrateur est une eau acide. C’est l’eau forte des alchimistes qui brûle et dissout les corps pour en faire des sels. Celle que les graveurs utilisaient à la Renaissance pour reproduire de nouvelles images. C’est donc une eau destructrice et créative à la fois, une eau de métamorphose qui – de même que le fleuve Léthé préside à la réincarnation des âmes – recompose le paysage.
Comme il y a dans la nouvelle de Basile Mulciba deux temporalités, il y a dans le récit de Claire Béchec deux géographies. La première est familière à qui connaît la baie de Saint-Brieuc : Briha fait penser à l’île de Bréhat, dont le point culminant est constitué d’un tertre rocheux, le Chrec’h Simon, haut de 35 mètres, et Léthé, me fait remarquer une amie, n’est pas sans évoquer le port du Légué. La seconde est plus conceptuelle. La Terre semble être redevenue « une mosaïque hétérogène, discontinue et régionale », telle que la définit la philosophe Jeanne Ételain dans son essai intitulé Zone (4). « Nous nous contentons d’ici, c’est déjà beaucoup », dit le narrateur d’Eaux fortes. Le monde s’est rétréci et l’écoumène s’est morcelé, mais c’est un pied de nez à une conception globalisante de la Terre qui a donné tant d’excès et d’injustices. Revenir au concept de zone nous sauvera-t-il ? (5)
Enfin il y a une tension apparente entre la citation de René Char en exergue : « Comment vivre sans inconnu devant soi » et la justification du narrateur de ne pas faire d’enfants : « Comment installer sur ce sol une nouvelle génération, alors que tout n’est qu’inconnu devant soi ? ». L’autrice épouse la quête poétique de René Char et pousse doucement son personnage – autant dire nous – à se « laisser flotter vers le monde qui suivra. » Le devenir de ce monde appartient à cette zone mouvante à la fois prévisible (on l’attendait) et imprévisible (pas si tôt, pas déjà, pas maintenant !), à cet espace capable de dynamiser le temps, de subvertir et de redéfinir une réalité qui nous échappe parce que nous avons été trop volontaristes et trop impuissants (6). Dans la nouvelle de Basile Mulciba, le protagoniste finit par admettre : « De toute façon, aujourd’hui, ni moi ni personne ne peut plus y faire grand-chose. » Cette acceptation, ce lâcher-prise (qui étaient déjà la proposition de Lucie Taïeb dans Trésors), laissent place au concept d’une nouvelle « mondiation », puisqu’il y a bien « un monde qui suivra », plus juste, plus humble et plus sensible espérons-le. À l’échelle de nos rêves.
1 – L’Enfant de la haute mer, Jules Supervielle- Éditions Gallimard, 1931
2- Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire, 1857. « Le Léthé » est le XXXème poème de la section.
3 – Par-delà nature et culture, Philippe Descola – Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 2005.
4 – Zone, Jeanne Ételain – Éditions Flammarion, coll. Terra incognita, 2025
5 – Écho à la phrase de Jeanne Ételain qui clôt son introduction : « Notre temps, peut-être, est celui des zones », eod. loc.
6- À l’instar de la Zone dans Stalker d’Andreï Tarkovski (1979), dont Jeanne Ételain fait une étude remarquable : « En rendant possible l’imprévisible, la Zone incarne une métaphysique du changement, l’évolution et la nouveauté sont au cœur de l’existence […] loin d’incarner la stabilité ou l’immobilité, [l’espace] devient un moteur du changement et un élément intrinsèquement lié au devenir du monde. » Op. cit. , p.68-69
Comment j’entre dans le récit?
J’ai la sensation d’être invitée dans le paysage de la narratrice. Impression de calme. Même la remarque sur les pontons rongés de sel qu’il faudra remplacer ne suscite en moi que l’image à laquelle elle renvoie, image familière pour qui a vécu toute sa vie en bord de mer.
Le premier indice troublant apparait au 3ème paragraphe : des fleurs ont disparu. Et puis au 4ème paragraphe une phrase résonne comme un véritable alerte : « Nous devons tous avoir une occupation déclarée et produire quelque chose» – c’est moi qui ajoute : « pour être en règle ». On entend le sous-texte. Même l’utilisation du verbe déclarer (un verbe qu’on prononce dans les zones de contrôles aux frontières, dans les aéroports…évoque la soumission obligatoire à une règle commune, renvoie à une société qui encadre fortement ses citoyens)
Il faut attendre la page 2 pour comprendre l’origine du changement des habitudes de vie : le dérèglement climatique.
Conclusion : l’entrée dans ce qui noue le récit de Claire Bechec est progressive, à l’inverse de la fiction de Basile Mulciba qui commence par une phrase – apparemment banale – mais qui crée une alerte : « La porte de la salle de bains ne ferme plus.»
Quelle mémoire de l’ancien monde ?
« Autrefois, c’était sûrement une partie d’un vaste territoire relié aux autres, dont il ne subsiste plus que ces étroits points culminants, ici et là, au-dessus des eaux, où nous vivons les autres hommes et moi. » On entend en creux que le monde habité est désormais un ensemble d’îles et la carte de ce nouveau monde n’est pas connue. Plus haut, le narrateur avoue son ignorance : « Personne ne sait vraiment ce qui se passe plus loin. »
La mémoire de l’ancien monde semble perdue. Chez Stéphane Nappez – Le repos du tigre – c’est pareil. Le vieil homme connaissait le monde d’avant mais pas le jeune homme avec qui il discute. Dans Rudimenteurs de Alexis Fichet, Naphta cherche à comprendre comment la catastrophe est arrivée. Il devient arpenteur des déchets pour reconstituer un passé dont finalement il obtient le récit par les anciens. Chez C. Béchec, personne pour sauver la mémoire du monde d’avant. Le narrateur est seul et la radio semble n’avoir pour unique fonction que le bulletin météo et la mention de la montée des eaux.
L’île, thème cher à la littérature.
Le site Babelio recense 42 ouvrages qui ont l’île comme territoire. (https://www.babelio.com/liste/1211/Lile-dans-la-litterature) Résider dans une île peut-être le résultat d’un naufrage (dès l’Odyssée) d’une réclusion volontaire ou forcée ( les bagnes étaient souvent dans des îles) . Le narrateur aurait pu habiter dans une île plus grande, moins menacée, car ici la submersion est irrémédiable : « Réfugié le plus haut possible au-dessus du destin, sur un toit que je n’aurai peut-être pas la force de quitter, sauf pour me laisser flotter vers le monde qui suivra.»
Mais y habiter seul renvoie bien sûr au plus célèbre d’entre-eux : Robinson Crusoé. Dans la bibliothèque de la BDF, on trouve une fiction écrite par Alexis Fichet inspirée par le roman de Defoe : Vendredi soir. Le patronyme Robinson désigne plusieurs entités, il y a 7 courtes nouvelles en tout et l’une d’elles commence ainsi : « Robinson est une candidate de télé-réalité délaissée sur une île minuscule et déserte. L’épreuve de survie individuelle suivait son cours quand la troisième guerre mondiale a éclaté, forçant la production à rapatrier un maximum de monde en un minimum de temps.» Comme le narrateur d’Eaux-fortes, la candidate Robinson a peu à peu apprivoisé son environnement et comme lui se laisse gagner par la beauté des lieux qu’elle explore: « Elle marche doucement parmi cette architecture du temps et de l’eau, elle est touchée par la beauté qui s’offre à elle. »
Claire Béchec, quant à elle, écrit : « Le soleil est doux ce matin et je trempe mes pieds dans l’eau, sous le ponton. Contact frais et bienfaisant. Le clapotis me donne l’impression d’être au bord d’un lac. Tout est lisse. Etrangement silencieux.» Pouvons-nous entendre ici un écho de la phrase prononcée par le prince Mychkine dans l’Idiot de Dostoievski : « La beauté sauvera le monde » ?
Le violoncelle
Il y a un autre personnage dans cette fiction : le violoncelle. Le personnage est seul et il joue du violon-celle. Étrange et beau nom que celui de cet instrument dont la sonorité est souvent comparée à celle de la voix humaine. Malgré son genre, ce mot a quelque chose de féminin. Il est très rare qu’un mot dont la dernière syllabe est «celle» soit masculin. Ficelle, radicelle, nacelle, escarcelle… Je crois même que violoncelle est le seul. Il y a donc quelque chose de féminin dans violoncelle, et – allons plus loin – pour en jouer, l’interprète doit approcher le corps de l’instrument du sien, le caler entre ses jambes écartées. Il y a là un rapport sensuel évident et pour le narrateur consolant :
«Quand je joue du violoncelle, c’est parce que j’éprouve une intense émotion. Telle qu’il me faudrait pouvoir l’exprimer par des mots, mais je ne sais comment le faire et je n’ai personne à qui les adresser. C’est le plus souvent de la peine.»
Le monde d’après
« Je ne connais pas le monde d’avant, personne ne le connaît vraiment. L’aurais-je aimé ? L’aurais-je aimé autant que ce monde-ci ?»
Le paradoxe c’est que le narrateur aime le monde dans lequel il vit malgré toutes ses contraintes. Une grande paix se lit dans les lignes suivantes :
« J’aime ces eaux voraces qui nous ont presque tout pris, j’aime m’y baigner quand il fait beau, je joue de la musique pour elles. Je ne leur en veux pas de leur intrusion. Elles nous enveloppent comme une chaleur primordiale dans laquelle nous pourrions finir par nous immerger de nouveau.»
Une hypothèse : à partir du moment où la nature dicte sa loi et que celle-ci est incontournable, une forme de sérénité apparait. De la résignation, oui, mais consentie et presque un soulagement. On retrouve ce calme chez le narrateur de Basile Mulciba dans Le grand affaissement :
« Cet immeuble, il ne s’écroulera pas avant 20 voire 25 ans. Pas besoin de me presser, j’ai le temps de voir venir comme on dit. De toute façon, aujourd’hui, ni moi ni personne ne peut plus y faire grand-chose.»
Ces deux textes – Le grand affaissement et Eaux fortes – contrastent fort avec beaucoup de fictions de la BDF par cette résignation calme à la destruction annoncée de leur monde. Il y a une sorte de parenté entre les deux . Claire Béchec emploie d’ailleurs une expression très proche du titre de Mulciba dans la phrase suivante : «Ce n’est pas encore pour cette fois, le grand engloutissement.»
Dans ces deux récits, écrits quasiment en même temps, on assiste à deux réactions identiques chez les protagonistes : la conscience des périls à venir n’entraine pas de révolte, la lucidité s’accompagne d’une forme de résignation, peut-on dire heureuse ? Sans doute pas, mais apaisée oui.
« La musique grave des cordes tient à distance les mots que j’ai entendus, la disparition de mon monde, la vision des oliviers noyés, de la maison engloutie. Je ferme les yeux et j’oublie que je me tiens sur le bord de l’abîme. »
« La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. »
René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946
Un homme fixe l’horizon. Absorbé dans la contemplation des eaux qui l’encerclent, il chérit le monde qui est le sien. Amarré à son îlot-royaume, il oscille entre action et inaction, sur le fil d’activités « ténues », « fragiles », qui pourtant suffisent à remplir sa vie solitaire. Libre, cet homme l’est, bien qu’il vive dans un monde régi par des lois autoritaires. Cet îlot ne peut être qu’un refuge, le lieu d’une parfaite harmonie entre soi et soi. Un certain art de vivre, l’otium, y est permis. Il suffit de se laisser porter par le charme de ces eaux mortifères et amies, car l’enseignement prodigué à l’école du Léthé invite à cette forme de nonchalance et d’abandon. A quoi bon lutter, se battre, quand il s’agit avant tout de s’adapter, et d’accepter ce qui vient ?
Malgré la noirceur implacable de cette nouvelle dont la morsure s’imprime en nous avec la délicatesse d’un coquelicot aux ailes froissées, sa lecture procure un sentiment d’apaisement, nous rappelle à la beauté du monde, quelle que soit sa datation historique. Ce monde-là, presque englouti, « sur le bord de l’abîme », suscite une rêverie mélancolique. Il fait également rêver – plus de fureur guerrière, plus de technologie avilissante et aliénante – juste l’être humain confronté à ses propres capacités manuelles et intellectuelles, à une solitude qui ne semble pas peser, mais se vit comme une forme de normalité partagée. De loin en loin se profilent des présences, sur d’autres îlots formant autant de monades silencieuses. Le fracas du monde est absorbé dans un archipel relié par une même attente : la certitude que rien ne subsistera, de ce qui formait le socle des sociétés humaines. Mais à quelle échelle du temps nous situons-nous ?
Ainsi, quand on sait que l’altitude des Monts d’Arrée au Paléozoïque atteignait plusieurs milliers de mètres, on change de perspective, on revient vers plus d’humilité, et un sentiment d’acceptation. Restons au ras de ces îlots condamnés mais superbes.
« Le grand engloutissement », « la grande menace » de ces Eaux-fortes, « le grand effondrement » chez Basile Mulcida: l’imminence de la disparition des sociétés humaines parcourt de nombreux textes de la BDF. Ici, l’être humain agit et rêve tout ensemble, sans que rien ne vienne troubler un quotidien fait de petits riens, d’un humble rapport aux choses, dans une économie de moyens qui est le seul viatique possible pour adopter des moyens d’existence à la hauteur de la disparition annoncée.
Claire Béchec dessine une cartographie des îles ( bretonnes) qui forme un pays fantasmatique et séduisant, presque métaphysique. Grâce aux objets – une tasse en grès façonnée par des mains fraternelles, un violoncelle aux accents élégiaques, une radio aux ondulations capricieuses – la solitude n’est pas redoutable : ils maintiennent le lien entre les êtres humains, ils sont les témoins d’une humanité créatrice. Cette solitude ontologique constitue la seule réponse possible à l’engloutissement majeur qui n’épargnera aucun. La nostalgie a lieu d’être, mais elle est gommée par l’oubli, la dépossession de la connaissance du monde d’avant.« Je ne connais pas le monde d’avant, personne ne le connaît vraiment. L’aurais-je aimé ? L’aurais-je aimé autant que ce monde-ci ? » Voici où nous conduit ce récit : à l’amour du monde tel qu’il est, dégradé, abîmé, offert à de multiples cités d’Ys où disparaître dans une forme de joie farouche. Car « il semble qu’on puisse trouver des solutions à tout. »
« L’île d’Arz rayée aux trois quarts de la carte. La réserve naturelle de Séné engloutie en partie. Quiberon et Saint-Pierre-Quiberon sur une île. Gâvres sous les eaux. Carnac sérieusement amputé par la mer. L’île de Saint-Cado disparue. La presqu’île de Conleau, l’extrémité de la pointe des Poulains et l’isthme de Penthièvre immergés totalement. L’île d’Hoedic réduite de moitié. Il ne s’agit pas d’un scénario catastrophe, mais d’une étude sur les risques de submersion marine publiée par l’association Climate Central, fin octobre 2019, dans la revue scientifique Nature Communications. » ( source Internet, article Ouest-France, 2019) : « nous vivons sur les sommets d’autrefois. », nous rappelle le narrateur sur le point de perdre pied dans un ultime et sublime coup d’archet.
Que faire de toutes ces peurs qui nous encombrent ? Dans le fameux tableau de Brueghel l’Ancien, Icare chute dans les eaux, sans que nul autour, affairé, ne voie le drame qui pourtant se joue sous ses yeux. Les Eaux-fortes, dont la morsure est cruelle, qui ronge patiemment et semble-t-il inexorablement, notre matrice monde, nous invite à la lucidité. Cette connaissance violente, cette conscience tragique nous conduit pourtant vers une autre issue que celle du désespoir. A l’ère de l’anthropocène, de la montée des eaux et du réchauffement climatique, regardons ce qui vient sans effroi. Aimons « ces eaux voraces qui nous ont presque tout pris ». Ne leur en voulons pas « de leur intrusion. Elles nous enveloppent comme une chaleur primordiale dans laquelle nous pourrions finir par nous immerger de nouveau. » Quelle élégance et quelle grâce conviées par la présence d’un violoncelle propice à l’envol, accompagnant la terrifiante musique des abîmes ! L’espoir surgit toujours de la boîte de Pandore. « Le monde qui suivra » ne sera peut-être pas plus affreux, ni plus beau. Il sera. Et l’être humain l’aimera, le chérira, car telle est sa nature.
Claire BÉCHEC

Claire Béchec enseigne les langues anciennes et la littérature à Saint-Brieuc. Elle est née au seuil des années 80, quelque part en Alsace, mais est depuis longtemps bretonne de cœur et de conviction. Sa littérature se situe là où les brumes fantômatiques se lient aux franges du réalisme, là où tout devient possible, Une littérature d’atmosphère, de ressentis, d’entre-deux. Derrière le soleil, la clarté du style, on sent venir au loin les ombres qui cherchent la lumière.